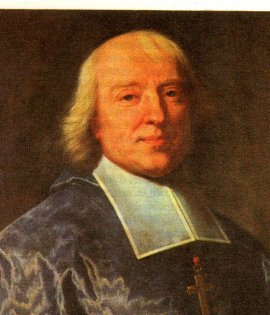|
(1627-1704) |
Considérez, Messieurs, ces grandes puissances que nous regardons
de si bas ; pendant que nous tremblons sous leur main, Dieu les frappe pour
nous avertir. Leur élévation en est la cause ; et il les épargne si peu qu'il
ne craint pas de les sacrifier à l'instruction du reste des hommes.
Chrétiens, ne murmurez pas si Madame a été choisie pour nous donner une telle
instruction : il n'y a rien ici de rude pour elle, puisque, comme vous le
verrez dans la suite, Dieu la sauve par le même coup qui nous instruit. Nous
devrions être assez convaincus de notre néant : mais s'il faut des coups de
surprise à nos cœurs enchantés de l'amour du monde, celui-ci est assez grand
et assez terrible. Ô nuit désastreuse ! ô nuit effroyable, où retentit tout à
coup comme un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle : Madame se meurt !
Madame est morte ! Qui de nous ne se sentit frappé à ce coup, comme si
quelque tragique accident avait désolé sa famille ? Au premier bruit d'un mal
si étrange, on accourut à Saint-Cloud de toutes parts ; on trouve tout
consterné, excepté le cœur de cette Princesse ;
partout on entend des cris; partout on voit la douleur et le désespoir, et
l'image de la mort. Le Roi, la Reine, Monsieur, toute la Cour, tout le peuple, tout est abattu,
tout est désespéré ; et il me semble que je vois l'accomplissement de cette
parole du prophète : "Le roi pleurera, le prince sera désolé et les
mains tomberont au peuple de douleur et d'étonnement." Mais et les princes et les peuples gémissaient en vain ; en vain
Monsieur, en vain le Roi même tenait Madame serrée par de si étroits
embrassements. Alors ils pouvaient dire l'un et l'autre, avec Saint
Ambroise : Stringebam brachia, sed jam amiseram quam tenebam : « je serrais les bras ; mais j'avais
déjà perdu ce que je tenais ». La princesse leur échappait parmi des
embrassements si tendres, et la mort plus puissante nous l'enlevait entre ces
royales mains. Quoi donc ! Elle devait périr si tôt ! Dans la plupart des
hommes les changements se font peu à peu, et la mort les prépare ordinairement
à son dernier coup. Madame cependant a passé du matin au soir, ainsi que
l'herbe des champs. Le matin, elle fleurissait ; avec quelles grâces, vous le
savez : le soir, nous la vîmes séchée ; et ces fortes expressions, par
lesquelles l' écriture sainte exagère l'inconstance
des choses humaines, devaient être pour cette princesse si précises et si
littérales . |
|
|
|
|
Bossuet (1627-1704) : après
des études chez les jésuites, il est ordonné prêtre et devient chanoine de Metz.
Très pieux, il se consacre à son sacerdoce et connaît le succès comme
prédicateur. Influencé par saint Vincent de Paul, il épure son style. Il
prend la parole devant la Cour et devient évêque en 1669. En 1670, il est
nommé précepteur du fils de Louis XIV, le Grand Dauphin. En 1671, il entre à
l'Académie française. En 1681, il devient évêque de Meaux (son surnom est
"l'Aigle de Meaux"). Durant toute sa carrière, il s'est montré un
redoutable polémiste: contre les protestants, contre les jésuites en défendant
l'Eglise de France contre l'autorité excessive du Pape, contre les
"quiétistes" comme Fénelon. Son œuvre : Les sermons: Il en a écrit et prononcé près
de 200, dont il reste la préparation qu'il développait en chaire. Le plus
connu est le Sermon sur la mort (1662). Les panégyriques: Le
panégyrique consiste à faire l'éloge d'un saint pour en montrer les vertus à
imiter. Le plus connu est le Panégyrique de Saint Paul (1659). Les oraisons
funèbres: Commandée par la mort d'un grand personnage,
l'oraison funèbre est un genre très solennel. Celles d'Henriette de France en
1670, d'Henriette d'Angleterre en 1670, et celle du Grand
Condé en 1687 sont les plus célèbres. Evocation du défunt, leçon de grandeur
morale composent ces discours. Discours sur l'histoire universelle: Ce texte
publié en 1681 est un véritable cours d'histoire composé pour l'instruction
du Grand Dauphin. Le but de Bossuet est de démontrer le rôle tout-puissant de
la Providence dans l'histoire et de tracer le portrait
du vrai roi catholique. Les ouvrages polémiques: Il a
toujours cultivé la controverse avec les protestants. En 1688, il écrit l'Histoire
des variations des Eglises protestantes. En 1694, il fait paraître
des Maximes et réflexions sur la comédie, où il condamne le
théâtre qui déprave les mœurs. En 1698, il fait paraître sa Relation
sur le quiétisme. 1) La situation d’énonciation : - Bossuet
est depuis peu évêque et précepteur du fils de Louis XIV :
il est donc revêtu d’une grande autorité morale (le caractère injonctif de
l’oraison souligne cette autorité : Considérez, Messieurs /
Chrétiens, ne murmurez pas.). Le cercueil de la belle-sœur du roi est à
ses pieds ; son public est principalement constitué des membres de la
noblesse. La thèse de son discours est que la mort des grands a un sens, elle
est une leçon pour le reste des hommes, une preuve de la toute-puissance de
Dieu. - Mais
le système des pronoms personnels révèle que le dessein de Bossuet est
surtout de ne faire qu’un, en tant que mortel, avec son assistance, d’où
l’utilisation de la 1ère personne du pluriel (nous regardons
/ nous tremblons / pour nous avertir /
pour nous donner telle ou telle instruction / qui nous instruit
/ Nous devrions être assez convaincus de notre néant
/ nos cœurs enchantés / Qui de nous ne se
sentit frappé / la mort plus puissante nous l'enlevait
/ nous la vîmes séchée). La seule intervention du
“ je ” est précisément celle où Bossuet
cite et interprète la Bible (il me semble que je vois
l'accomplissement de cette parole du prophète) : cette irruption du
“ je ” l’isole alors momentanément de son assistance et souligne
son autorité de prêtre. - Le
discours suit les préceptes de la rhétorique
classique fondée sur le movere (=
émouvoir), le delectare (= plaire)
et le docere (= instruire) :
la première partie repose sur le docere (l.1-11) ;
la seconde sur le movere, c’est la
narration pathétique de la mort de Madame. 2) Le pathétique (= movere) : L’évocation de la mort de Madame
est en contraste avec l’avertissement liminaire (Chrétiens, ne murmurez
pas si Madame a été choisie pour nous donner telle ou telle instruction : il
n'y a rien ici de rude pour elle). Toutes les figures de style soulignent
au contraire le pathétique : - Les
exclamations (O nuit désastreuse ! ô nuit effroyable), renforcées par
le parallélisme. - Les
questions oratoires (Qui de nous ne se sentit frappé à ce coup, comme si
quelque tragique accident avait désolé sa famille ? / Quoi donc ! elle devait
périr sitôt ?). - Redondances et
hyperboles (assez grand et assez terrible / comme
un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle). - Les
anaphores (Madame se meurt ! Madame est
morte ! / partout on entend des cris ; partout on
voit la douleur et le désespoir / en vain Monsieur, en
vain le roi), auxquelles s’ajoutent les accumulations (Le
roi, la reine, Monsieur, toute la cour, toute la
cour, tout le peuple, tout est
abattu, tout est désespéré). - Les polysyndètes (et les
princes et les peuples gémissaient en vain). - Hypotypose soulignée
par le présent de narration (on trouve tout consterné, … on entend des
cris … on voit la douleur et le désespoir… tout est abattu, tout est
désespéré). - Métaphore
filée (ainsi que l'herbe des champs : le matin elle fleurissait … le soir
nous la vîmes séchée). 3) Bossuet intermédiaire entre Dieu et les hommes
(= docere) - Par
sa position même, sur la chaire, Bossuet est au-dessus des hommes, mais en
dessous de Dieu : il est là pour instruire les hommes en interprétant
les actions de Dieu (sacrifier à l'instruction du reste
des hommes). - L’Écriture sainte est donc alors
utilisée par Bossuet, de trois façons : - D’abord
la citation (en français) d’Ezéchiel évoque
un Dieu vengeur, qui punit les crimes des hommes : c’est l’image de la
toute-puissance de Dieu. - Ensuite
la citation (d’abord en latin, puis en français) de Saint
Ambroise (Discours sur la mort de son frère 1, 19) a le
prestige de la langue sacrée : elle évoque au contraire la faiblesse de
l’homme. - La
comparaison finale, très banale dans la poésie amoureuse (Madame cependant
a passé du matin au soir, ainsi que l'herbe des champs : le matin elle
fleurissait ; avec quelles grâces, vous le savez : le soir nous la vîmes
séchée) s’inspire des Psaumes 102(“ mes
jours sont comme l'ombre qui décline, et moi comme l'herbe je sèche ”)
et 103 (“ L'homme! ses jours sont comme
l'herbe, comme la fleur des champs il fleurit; sur lui, qu'un souffle passe,
il n'est plus ”). Les Psaumes sont
un recueil de prières qui établissent un dialogue entre Dieu et les hommes,
de la même façon que le prêtre : le texte ici joue le même rôle que
l’orateur, un intermédiaire entre Dieu et les hommes. |
|
|
|