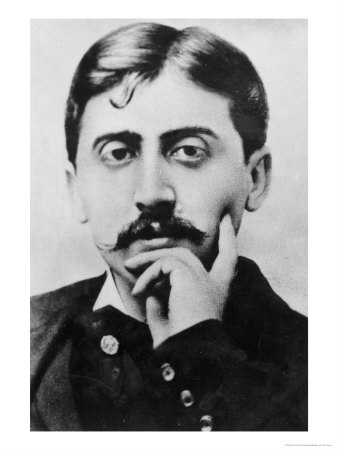Marcel Proust, Du
côté de chez Swann
|
|
Incipit |
Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se
fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me dire : « Je
m’endors. » Et, une demi-heure après, la pensée qu’il était temps de
chercher le sommeil m’éveillait ; je voulais poser le volume que je
croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière ; je n’avais
pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire,
mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier ; il me
semblait que j’étais moi-même ce dont parlait l’ouvrage : une église, un
quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles-Quint. Cette croyance
survivait pendant quelques secondes à mon réveil ; elle ne choquait pas
ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se
rendre compte que le bougeoir n’était pas allumé. Puis elle commençait à me
devenir inintelligible, comme après la métempsycose les pensées d’une
existence antérieure ; le sujet du livre se détachait de moi, j’étais
libre de m’y appliquer ou non ; aussitôt je recouvrais la vue et j’étais
bien étonné de trouver autour de moi une obscurité, douce et reposante pour
mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait
comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment
obscure. Je me demandais quelle heure il pouvait être ; j’entendais le
sifflement des trains qui, plus ou moins éloigné, comme le chant d’un oiseau
dans une forêt, relevant les distances, me décrivait l’étendue de la campagne
déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine ; et le petit chemin
qu’il suit va être gravé dans son souvenir par l’excitation qu’il doit à des
lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux
sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit, à
la douceur prochaine du retour. J’appuyais tendrement mes joues
contre les belles joues de l’oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme
les joues de notre enfance. Je frottais une allumette pour regarder ma
montre. Bientôt minuit. C’est l’instant où le malade qui a été obligé de
partir en voyage et a dû coucher dans un hôtel inconnu, réveillé par une
crise, se réjouit en apercevant sous la porte une raie de jour. Quel
bonheur ! c’est déjà le matin ! Dans un moment les domestiques
seront levés, il pourra sonner, on viendra lui porter secours. L’espérance
d’être soulagé lui donne du courage pour souffrir. Justement il a cru
entendre des pas ; les pas se rapprochent, puis s’éloignent. Et la raie
de jour qui était sous sa porte a disparu. C’est minuit ; on vient d’éteindre
le gaz ; le dernier domestique est parti et il faudra rester toute la
nuit à souffrir sans remède. Je me rendormais, et parfois je
n’avais plus que de courts réveils d’un instant, le temps d’entendre les
craquements organiques des boiseries, d’ouvrir les yeux pour
fixer le kaléidoscope de l’obscurité, de goûter grâce à une lueur momentanée
de conscience le sommeil où étaient plongés les meubles, la chambre, le tout
dont je n’étais qu’une petite partie et à l’insensibilité duquel je
retournais vite m’unir. Ou bien en dormant j’avais rejoint sans effort un âge
à jamais révolu de ma vie primitive, retrouvé telle de mes terreurs
enfantines comme celle que mon grand-oncle me tirât par mes boucles et
qu’avait dissipée le jour — date pour moi d’une ère nouvelle — où on les
avait coupées. J’avais oublié cet événement pendant mon sommeil, j’en
retrouvais le souvenir aussitôt que j’avais réussi à m’éveiller pour échapper
aux mains de mon grand-oncle, mais par mesure de précaution j’entourais
complètement ma tête de mon oreiller avant de retourner dans le monde des
rêves. |