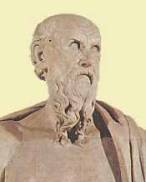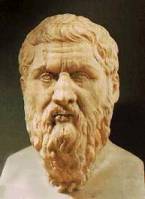|
|
Après avoir évoqué les diverses générations d’hommes qui l’ont précédé (l’âge d’or, l’âge d’argent, l’âge de bronze, l’âge des héros), Hésiode évoque l’âge de fer. Plût aux dieux que je ne vécusse pas au milieu de la cinquième génération ! Que ne suis-je mort avant ! que ne puis-je naître après ! C'est l'âge de fer qui règne maintenant. Les hommes ne cesseront ni de travailler et de souffrir pendant le jour ni de se corrompre pendant la nuit ; les dieux leur enverront de terribles calamités. Toutefois quelques biens se mêleront à tant de maux. Zeus détruira celte race d'hommes doués de la parole lorsque presque dès leur naissance leurs cheveux blanchiront. Le père ne sera plus uni à son fils, ni le fils à son père, ni l'hôte à son hôte, ni l'ami à son ami ; le frère, comme auparavant, ne sera plus chéri de son frère ; les enfants mépriseront la vieillesse de leurs parents. Les cruels ! ils les accableront d'injurieux reproches sans redouter la vengeance divine. Dans leur coupable brutalité, ils ne rendront pas à leurs pères les soins que leur enfance aura reçus : l'un ravagera la cité de l'autre ; on ne respectera ni la foi des serments, ni la justice, ni la vertu ; on honorera de préférence l'homme vicieux et insolent ; l'équité et la pudeur ne seront plus en usage ; le méchant outragera le mortel vertueux par des discours pleins d'astuce auxquels il joindra le parjure. L'Envie au visage odieux, ce monstre qui répand la calomnie et se réjouit du mal, poursuivra sans relâche les hommes infortunés. Alors, promptes à fuir la terre immense pour l'Olympe, la Pudeur et Tempérance, enveloppant leurs corps gracieux de leurs robes blanches, s'envoleront vers les célestes tribus et abandonneront les humains ; il ne restera plus aux mortels que les chagrins dévorants, et leurs maux seront irrémédiables. Hésiode, Les travaux et les jours (v.174-201) |
|
|
____________________________________________ Ayant distingué, au début de ce mythe, trois parties en chaque âme, j’ai assimilé les deux premières à deux chevaux et la troisième à un cocher. Continuons à nous servir encore de ces mêmes figures. Des deux chevaux, disions-nous, l’un est bon, l’autre est vicieux. Il reste à dire maintenant, puisque nous ne l’avons pas dit, en quoi consiste l’excellence de l’un et le vice de l’autre. Le premier a, des deux, la plus belle prestance ; sa forme est élancée et découplée ; il a l’encolure haute, les naseaux recourbés, la robe blanche, les yeux noirs ; il est avec tempérance et pudeur amoureux de l’estime, et pour ami, il a l’opinion vraie ; sans qu’on le frappe, par simple exhortation et par seule raison, il se laisse conduire. Le second au contraire est tortu, épais, jointuré au hasard ; il a le cou trapu, l’encolure épaisse, le visage camard, la robe noire, les yeux glauques ; il est sanguin, ami de la violence et de la vantardise ; velu tout autour des oreilles, il est sourd, et n’obéit qu’avec peine à l’aiguillon et au fouet. Quand donc le cocher, apercevant un objet digne d’amour, sent toute son âme se pénétrer de chaleur et se voit atteint par la démangeaison et l’aiguillon du désir, celui des deux chevaux qui est docile aux rênes, alors comme toujours dominé par la pudeur, se contient pour ne pas assaillir le bien-aimé. Mais l’autre coursier n’est détourné ni par le fouet ni par l’aiguillon du cocher ; il bondit et saute avec violence, donne toutes les peines à son compagnon d’attelage et à son cocher, et les contraint à se diriger vers le jeune garçon et à lui rappeler le souvenir du charme des plaisirs d’Aphrodite. Tout d’abord cocher et compagnon résistent, car ils sont indignés qu’on les pousse à des actes indignes et affreux. Mais à la fin, lorsque leurs maux n’ont plus de bornes, ils se laissent entraîner, cèdent et consentent à faire ce qu’il ordonne : ils s’attachent au bien-aimé et contemplent cette apparition fulgurante qu’est un aimé pour un amant. A cette vue, la mémoire du cocher se reporte vers la nature de la beauté, et il la revoit de nouveau affermie avec la tempérance sur un trône sacré. Cette vision le remplit de frayeur ; saisi de crainte, il se renverse sur le dos et tire en même temps et avec tant de force les rênes en arrière, que les deux chevaux sont contraints de s’asseoir sur leurs croupes, l’un de bon gré, car il ne résiste pas, et l’autre, le violent, tout à fait malgré lui. Tandis qu’ils se reculent, l’un, sous le coup de la pudeur et de la stupéfaction, inonde l’âme entière de sueur ; mais l’autre, guéri de la douleur que le mors et la chute lui causèrent, ayant à peine repris haleine, se répand en colères et charge d’outrages son cocher et son compagnon d’attelage sous prétexte qu’ils ont, par lâcheté et couardise, abandonné leur poste et violé leur accord. Il les contraint de revenir à la charge, et c’est à grand-peine qu’il cède à leurs prières de remettre à plus tard. Quand arrive le terme convenu, comme ils font semblant d’oublier, il les rappelle à leur engagement, les violente, hennit, tire sur les guides et les oblige pour de mêmes propos à s’approcher du bien-aimé. Quand ils s’en sont approchés, il se penche sur lui, raidit sa queue, mord son frein et tire avec impudence sur les rênes. Frappé d’une émotion plus forte, le cocher alors se rejette en arrière comme s’il allait franchir la barrière, tire avec plus de vigueur le mors qui est aux dents du cheval emporté, ensanglante sa langue diffamatrice et ses mâchoires, fait toucher terre à ses jambes et sa croupe, et le livre aux douleurs. Lorsqu’il a souffert à diverses reprises la même expérience, le coursier vicieux perd sa fougue, il obéit humilié à la prévoyance du cocher et, quand il voit le bel enfant, il se meurt de terreur. C’est alors seulement, avec respect et crainte, que l’âme de l’amant peut suivre le bien-aimé. Platon, Phèdre (253-254) ____________________________________________ |
|
Ce monstre arme le fils contre son propre père, Et le frère, ô malheur, arme contre son frère, La sœur contre la sœur, et les cousins germains Au sang de leurs cousins veulent tremper leurs mains, L’oncle fuit son neveu, le serviteur son maître, La femme ne veut plus son mari reconnaître. Les enfants sans raison disputent de la foi, Et tout à l’abandon va sans ordre et sans loi. L'artisan par ce monstre a laissé sa boutique, Le pasteur ses brebis, l'avocat sa pratique, Sa nef le marinier, sa foire le marchand, Et par lui le prud’homme est devenu méchant. L'écolier se débauche, et de sa faux tortue Le laboureur façonne une dague pointue, Une pique guerrière il fait de son râteau, Et l'acier de son coutre il change en un couteau. Morte est l'autorité; chacun vit en sa guise; Au vice déréglé la licence est permise; Le désir, l'avarice et l'erreur insensé Ont sens dessus-dessous le monde renversé. On fait des lieux sacrés une horrible voirie[1], Une grange, une étable et une porcherie, Si bien que Dieu n'est sûr en sa propre maison. Au ciel est revolée et Justice et Raison, Et en leur place, hélas! règnent le brigandage, La force, le harnois[2], le sang et le carnage. Tout va de pis en pis: le sujet a brisé Le serment qu'il devait à son Roi méprisé; Mars enflé de faux zèle et de vaine apparence Ainsi qu'une Furie agite notre France. Qui, farouche à son prince, opiniâtre suit L’erreur d’un étranger, qui folle la conduit. Tel voit-on le poulain dont la bouche trop forte Par bois et par rochers son écuyer emporte, Et malgré l’éperon, la houssine[3], et la main, Se gourme de sa bride[4], et n’obéit au frein : Ainsi la France court en armes divisée, Depuis que la raison n’est plus autorisée. Ronsard, Discours des
misères du temps (v.115-193) |
|
___________________________ Ronsard Discours des misères du temps (v.115-193) Ronsard n’est pas seulement l’auteur pétrarquisant des sonnets
amoureux (Cassandre, Hélène, Marie). A côté de cette poésie mineure, il
pratique la poésie majeure, celle des Hymnes (1555) ou de l’épopée
nationale de la Franciade (inachevée) ou comme ici dans les Discours
des misères du temps (1562), où il dénonce la religion protestante. 1) Peinture d’un monde violent -
Plutôt que de
recourir à un registre pathétique (ô malheur v.2 ; hélas !
v.25), Ronsard s’adonne à la polémique et utilise le registre épique
pour dénoncer les crimes de la Réforme : -
accumulations :
énumération en asyndète des v.1 à 16 ; une horrible voirie, un
assassinement et une pillerie (v.21-22), le brigandage, / La force,
les couteaux, le sang et le carnage (v.25-26), l’éperon, la houssine,
et la main (v.35). -
allégories et personnifications : Ce
monstre (v.1 et 9),le vice déréglé (v.18), Le désir,
l’avarice et l’erreur (v.19 : verbe d’action), Justice et
Raison (v.24), En leur place hélas ! règnent le brigandage, /
La force, les couteaux, le sang et le carnage (v.25-26), France
(v.30 et 37). -
personnages de
l’épopée ou de la mythologie : Mars (v.29), les Furies
(v.30). -
comparaison
homérique : caractérisée par une longue protase (Tel on voit le
poulain…), suivie d’un courte apodose (Ainsi la France court…). 2) Monde chaotique plein de vice -
Le texte
procède sur le mode de l’inversion (“ Le désir, l’avarice
et l’erreur insensée / Ont sens dessus dessous le monde renversé ”) :
la dissolution des liens qui unissent les membres d’une maisonnée (v.1-8)
s’étend d’abord aux membres de la société évoquée à travers des occupations
normalement pacifiques (v.9-16), puis à l’ensemble du pays (v.26-32). -
Ainsi le
respect dû au père, au maître, au mari ou aux parents disparaît parce qu’il
n’y a plus d’autorité : Morte est l’autorité
(v.17 avec antéposition expressive de l’adjectif), Depuis que la
raison n’est plus autorisée (v.38). La disparition des liens familiaux
implique la désobéissance au prince (v.31 : farouche à son prince),
considéré comme le père de ses sujets (d’où le terme foi v.28 qui
souligne le caractère sacré de ces liens). -
L’absence de
règle implique donc le chaos à tous les niveaux de la société :
il n’y a plus de loi, plus de règle (v.8 Et tout à l’abandon va sans
ordre et sans loi, v.18 vice déréglé). Au règne de la raison (v.12
prud’homme, v.24 et 38 Raison) succède celui de la folie (v. 19
l’erreur insensé, v.32 L’erreur d’un étranger qui folle la conduit). 3) Intertextualité -
Mais le texte
ne prend tout son sens que si l’on en comprend les allusions savantes. Membre
de la Pléiade, fin helléniste (cours de Dorat au collège de Coqueret),
Ronsard nourrit sa réflexion en puisant dans les textes de l’Antiquité. -
La première
intertextualité est évidente pour un helléniste : dans ce texte Ronsard
adapte un passage célèbre du poète grec Hésiode (VIIe siècle
av.J.C.) dans Les travaux et les jours. Hésiode raconte la progressive
déchéance de l’humanité à travers le mythe des races (d’or, d’argent,
de bronze et de fer) ; la race de fer est le stade ultime avant le
retour au chaos, et les point communs avec Ronsard sont nombreux (Zeus
détruira celte race d'hommes doués de la parole lorsque presque dès leur
naissance leurs cheveux blanchiront. Le père ne sera plus uni à son fils,
ni le fils a son père, ni l'hôte à son hôte, ni l'ami à son ami ; le frère,
comme auparavant, ne sera plus chéri de son frère ; les enfant mépriseront la
vieillesse de leurs parents. Les cruels ! ils les accableront d'injurieux
reproches sans redouter la vengeance divine. Dans leur coupable brutalité,
ils ne rendront pas à leurs pères les soins que leur enfance aura reçus : l'un
ravagera la cité de l'autre ; on ne respectera ni la foi des serments, ni la
justice, ni la vertu ; on honorera de préférence l'homme vicieux et insolent
; l'équité et la pudeur ne seront plus en usage : le méchant outragera le
mortel vertueux par des discours pleins d'astuce auxquels il joindra le
parjure. L'Envie au visage odieux, ce monstre qui répand la calomnie
et se réjouit du mal, poursuivra sans relâche les hommes infortunés. Alors,
promptes à fuir la terre immense pour l'Olympe, Pudeur et Tempérance,
enveloppant leurs corps gracieux de leurs robes blanches, s'envoleront vers
les célestes tribus et abandonneront les humains ; il ne restera plus aux
mortels que les chagrins dévorants, et leurs maux seront irrémédiables.). L’intertextualité suggère donc que les
guerres de religion sont un retour au chaos primitif, une sorte de fin du monde. -
La deuxième
intertextualité renvoie à un texte de Platon très célèbre lui aussi : le
mythe de l’attelage ailé dans le Phèdre. Socrate y compare l’âme
de l’homme à un attelage, tiré par deux chevaux ailés ; le premier
cheval (la raison) est sage et obéit au cocher, l’autre cheval (la passion
irraisonnée) se révolte et ne veut pas obéir au cocher (Quand donc le
cocher, apercevant un objet digne d’amour, sent toute son âme se pénétrer de
chaleur et se voit atteint par le prurit et l’aiguillon du désir, celui des
deux chevaux qui est docile aux rênes, alors comme toujours dominé par la
pudeur, se contient pour ne pas assaillir le bien-aimé. Mais l’autre
coursier n’est détourné ni par le fouet ni par l’aiguillon du cocher ; il
bondit et saute avec violence, donne toutes les peines à son compagnon
d’attelage et à son cocher, et les, contraint à se diriger vers le jeune
garçon et à lui rappeler le souvenir du charme des plaisirs d’Aphrodite.).
Dans le texte de Ronsard, la comparaison homérique finale renvoie donc à ce
texte de Platon, mais avec une différence notable : il n’y a plus le
cheval incarnant la Raison ; seul reste le cheval fou “ Depuis
que la Raison n’est plus autorisée ”. Cette comparaison prend
également sa force dans la valeur symbolique du cheval qui, outre qu’il est
l’animal guerrier du chevalier, est également dans l’Antiquité l’animal qui
était sacrifié au dieu Mars chez les Romains. Conclusion : Ronsard dénonce donc la religion réformée en insistant sur le danger
qu’elle fait courir à la France. La désobéissance et l’irrespect évoqués
dans le texte rappellent bien sûr que les protestants ne reconnaissent pas
l’autorité du pape. Mais, par les phénomènes d’intertextualité, Ronsard va
plus loin et élargit son sujet à l’univers : il laisse planer la menace
d’une sorte de fin du monde, due à l’impiété des hommes. |