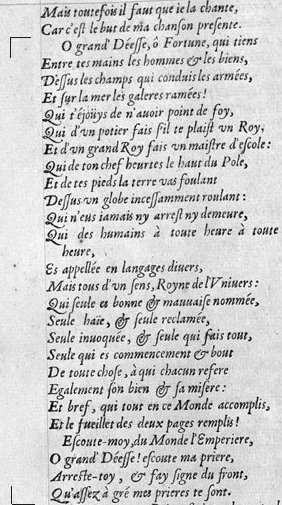Ronsard, Hymne à la Fortune
|
|
Ô grand’Déesse, ô Fortune, qui tiens Entre tes mains les hommes et les
biens, Dessus les champs qui conduis les
armées, Et sur la mer les galères
ramées ! Qui t’éjouis de n’avoir point de foi, Qui d’un potier fais s’il te plait un
Roi, Et d’un grand Roi fais un maître
d’école ; Qui de ton chef heurtes le haut du
Pôle, Et de tes pieds la terre va foulant Dessus un globe incessamment
roulant ; Qui n’eus jamais ni arrêt ni demeure, Qui des humains à tout heure à toute
heure, Es appelée en langages divers, Mais tout d’un sens, Reine de
l’Univers ; Qui seule es bonne et mauvaise nommée, Seule haïe, et seule réclamée, Seule invoquée, et seule qui fais
tout, Seule qui es commencement et bout De toute chose, à qui chacun réfère Egalement son bien et sa
misère ; Et bref qui tout en ce monde
accomplis, Et le feuillet des deux pages
remplis !
Ecoute-moi, du Monde l’Emperière, Ô grand’Déesse ! écoute ma
prière, Arrête-toi, et fais signe du front, Qu’assez à gré mes prières te sont. |
|
|
|
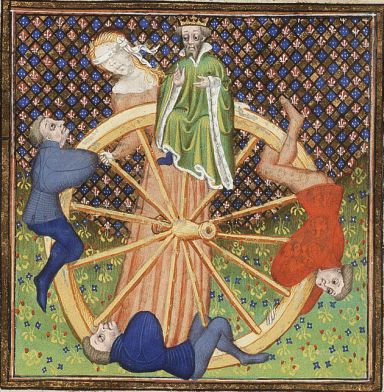
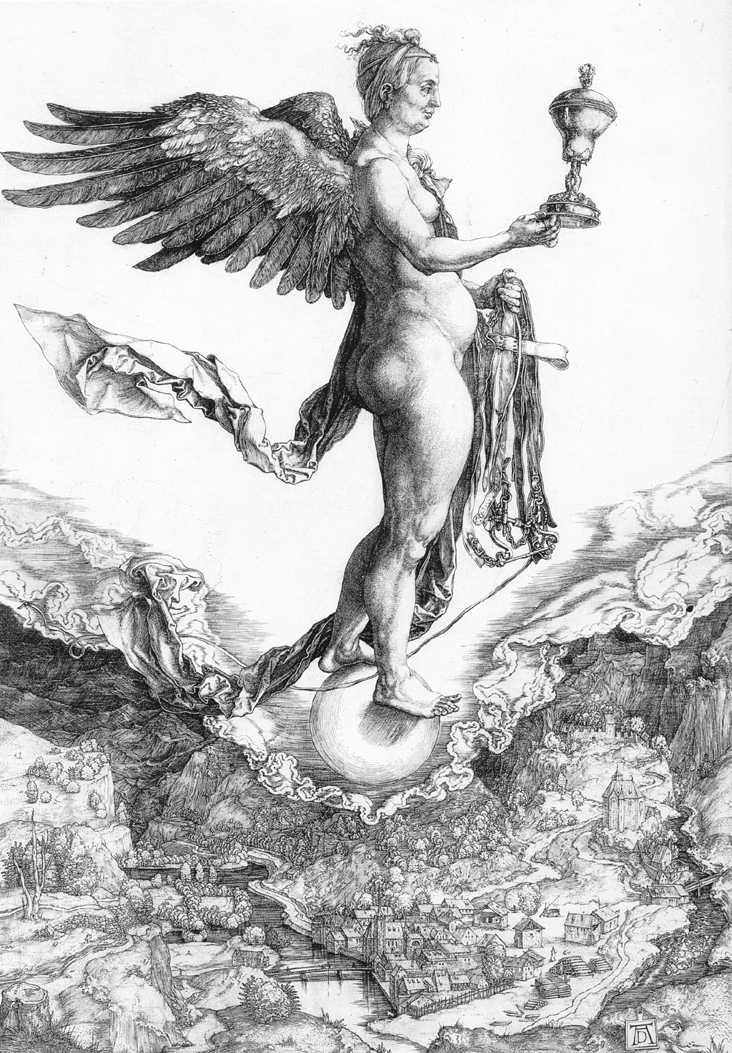
|
Alors que Ronsard est au sommet de sa gloire, reconnu
«prince des poètes», largement pensionné par la cour, il met en chantier la Franciade, épopée dont il abandonnera
la composition après quatre chants.
Mais auparavant, en 1555, il rencontre un immense succès avec les Hymnes dont il dit qu’ils sont un
« coup d’essai sur des patrons
estranges » : fidèle aux principes de la Pléiade il adapte en
français une forme antique, remontant à Homère. L’hymne est en principe la
glorification en vers d’une divinité ou d’un héros, sous forme épique ou
lyrique ; ce genre a une longue histoire puisque, après Homère, il sera
repris à l’époque hellénistique par Callimaque, puis par les poètes latins
(dont Horace), lesquels seront à leur tour adaptés par les auteurs chrétiens. Dans L’hymne
à la Fortune, il faut donc voir d’abord un jeu littéraire ; par
ailleurs nous nous interrogerons sur l’intérêt de cette prière à une déesse
double ; enfin nous verrons quel est le véritable sens symbolique qu’il
faut voir derrière ce jeu littéraire. D’entrée se pose la question
de la nature de cette prière, car il est pour le moins paradoxal qu’un
chrétien comme Ronsard adresse pareille supplique à une déesse païenne. Les
termes mêmes qu’utilise Ronsard pour désigner cette pièce sont
révélateurs : c’est à la fois une « chanson » (v.72) et une
« prière » (v.96), de sorte que l’identification de ce texte est
volontairement présentée par Ronsard comme problématique. La comparaison avec
l’Ode I, 35 d’Horace dont Ronsard
s’inspire révèle une partie de l’enjeu : il s’agit d’une imitation de
l’Antiquité en une variation personnelle, et l’on reconnaît là l’un des
principes de base de la Pléiade tels que les a définis Du Bellay dans La Défense et Illustration de la Langue
Française. L’adresse « O
Grand’Deesse » est une traduction fidèle d’Horace ; l’évocation
par Horace des diverses populations de l’empire romain est condensée dans les
vers 84-85. Mais on voit aussi les interventions de Ronsard sur le modèle
horatien : alors qu’Horace parle d’un monde de paix, Ronsard évoque dans
les vers 75-76 un monde en guerre avec les armées sur le champ de bataille et
les « galeres ramées »,
c’est-à-dire des vaisseaux de guerre. De même la présentation en chiasme des
vers 78-79 (potier, roy, roy, maistre d’escole)
est certainement, dans la forme circulaire de cette figure, un souvenir de
l’image traditionnelle de la roue de Fortune qui illustrait en particulier
les tarots de l’époque. On retrouve donc là la
conception que les auteurs du XVIe siècle avait de
l’originalité : il ne s’agissait pas de trouver un thème original, mais
au contraire de choisir un sujet rebattu en le traitant sous une forme
personnelle et en lui donnant en même temps un autre sens. Ce jeu littéraire
est confirmé par la dimension ironique de certains passages, comme lorsque
Ronsard souligne l’absurdité de prier une divinité dont on souligne d’emblée
le manque de parole (« Qui
t’esjouïs de n’avoir point de foy »), ou lorsqu’il demande à cette
divinité foncièrement instable (Dessus
un globe incessamment roulant) et toujours en mouvement (Qui n’eust jamais ny arrest ny demeure)
de ne plus être ce qu’elle est par essence (v.97 « Arreste toy »). Il s’agit donc d’autre chose
qu’une prière : nous avons affaire un jeu qui devient déchiffrement, à
un texte à double sens qui demande à être interprété, d’où l’adresse à
une divinité double. L’adresse à la déesse imitée
d’Horace se double (v.80-83) d’une description qui s’inspire directement de
l’iconographie du temps, telle qu’on peut la voir par exemple dans Die grosse Fortuna de Dürer. De fait,
dans cette description les symboles s’accumulent comme dans les
représentations picturales, de sorte que l’on peut dire que nous avons
affaire dans ces vers à une ekphrasis.
Le texte adopte d’une certaine manière une présentation en diptyque,
soulignée par le parallélisme des vers 80-81 (chef-pole / pied- terre).
Cette forme double est particulièrement adaptée à l’évocation d’une divinité
paradoxale dont Ronsard va souligner à l’envi l’ambiguïté : les
anaphores de Seule dans les vers 87
à 94 soulignent les couples d’opposition. L’instabilité foncière de la
Fortune est elle-même suggérée par le déséquilibre des vers, soit par un
rejet (Seule qui es commencement &
bout / De toute chose), soit par un contre-rejet (à qui châcun refere / Egualement son bien & sa misere). La déesse est ainsi
curieusement rapprochée du Dieu biblique : « Seule qui es commencement & bout » fait référence à l’Apocalypse (« Je suis l’Alpha et
l’Oméga, le Premier et le Dernier, le Début et la Fin » I, 8 ; 21,
6 ; 22, 13), nouveau clin d’œil de Ronsard qui suggère par là que les
hommes de son temps se sont détournés du Christ, qu’ils ont perdu leur
confiance en Dieu et se fient follement au hasard. Cette duplicité de la déesse en fait un être à double
face, d’où une nouvelle métaphore au v.94, « le fueillet des deux pages remplis » : l’écriture de
Ronsard est à l’image de son sujet, ou plutôt pourrait-on dire le sujet est à
l’image de l’écriture. Cette déesse qui écrit sur les deux pages d’une
feuille représente l’incertitude sur ce qui est écrit quelque part pour nous,
sur ce qui nous est destiné : une chose (ou son contraire) peut nous
arriver, seule Fortune décide. Cette hésitation se retrouve donc tout
naturellement dans le texte de Ronsard lui-même qui hésite sur le nom à
donner à son texte : s’agit-il de quelque chose de léger, une chanson, ou bien de grave comme une prière ? Le double statut de la déesse
engendre donc un texte à double sens ; mais cette dualité intrinsèque
correspond aussi au double statut du poète. En imitant Horace, Ronsard ne se limite pas à un simple
jeu littéraire, il s’assimile par là-même à ce que les Romains appelaient un vates, terme qui désigne à la fois un
devin, un prophète ou un poète inspiré par les dieux. Ce statut du vates est revendiqué à l’époque
augustéenne par de nombreux poètes, dont en particulier Virgile et son ami
Horace. La notion de « fureur poétique », si fréquente chez Ronsard
ou Du Bellay, s’inspire directement de cette conception antique de
l’inspiration. Ainsi en tant que vates,
et dans le cadre de ce jeu littéraire, Ronsard peut être l’intermédiaire
entre les dieux et les hommes et s’adresser directement à une divinité aussi
redoutable : comme dans l’Antiquité où le pouvoir magique des mots est
très important, Ronsard prend soin de s’adresser à la déesse avec les
épithètes appropriées : grand’Deesse
(v.73 et 96), royne de l’Univers
(v.86), du monde l’Emperiere
(v.95). Mais en même temps, investi de
la puissance du vates, Ronsard peut
donner des leçons aux puissants, en particulier aux rois qui oublient le
message du Christ et tuent des hommes dans les guerres : on comprend
mieux dès lors pourquoi, dans les vers 75-76, Ronsard substitue au monde
paisible évoqué par Horace un monde de guerre. Les nombreuses allusions à la
royauté confirment que le texte se veut avant tout une leçon de morale aux
puissants : comme dans les représentations de la roue de Fortune, les
rois peuvent déchoir s’ils ne se fient qu’à la Fortune au lieu de suivre le
message du Christ, d’où le jeu sur l’alpha et l’oméga qui montre que pour ces
rois chrétiens la Fortune a remplacé Dieu. A ces rois en définitive si
faibles sans l’aide de Dieu s’oppose la royne
de l’Univers, l’Emperiere du monde,
une géante dont la tête heurte « le
haut du pole ». Ainsi, paradoxalement, la
prière à la Fortune est une réhabilitation du message du Christ. Ce qui se
donnait pour un jeu littéraire s’avère en fait être une sévère leçon de
morale à l’usage des puissants de ce monde qui ont remplacé la Providence
divine par la Fortune aveugle et sans foi. Le « prince des poètes »
se montre donc à l’occasion le conseiller des princes, audace qui n’est guère
possible que dans le cadre d’une intertextualité où Ronsard joue le rôle
d’Horace et ou le roi Henri II est à la place d’Auguste. Cette dimension
politique de l’écrivain n’est pas propre à la Renaissance, bien au
contraire : quelques siècles plus tard Victor Hugo se fera, tel un
« mage » l’intermédiaire entre Dieu et les hommes et fustigera à sa
façon « Napoléon le petit ». |