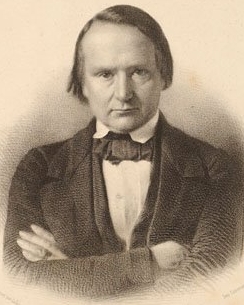|
|
Dans un vaste espace laissé libre entre la foule et le feu, une jeune fille dansait. Si cette jeune fille était un être humain, ou une fée, ou un ange, c’est ce que Gringoire, tout philosophe sceptique1, tout poète ironique qu’il était, ne put décider dans le premier moment tant il fut fasciné par cette éblouissante vision. Elle n’était pas grande mais elle le semblait tant sa fine taille s’élançait hardiment. Elle était brune, mais on devinait que le jour sa peau devait avoir ce beau reflet doré des Andalouses et des Romaines. Son petit pied aussi était andalou car il était tout ensemble à l’étroit et à l’aise dans sa gracieuse chaussure. Elle dansait, elle tournait, elle tourbillonnait sur un vieux tapis de Perse, jeté négligemment sous ses pieds ; et chaque fois qu’en tournoyant sa rayonnante figure passait devant vous, ses grands yeux noirs vous jetaient un éclair. Autour d’elle tous les regards étaient fixes, toutes les bouches ouvertes, et, en effet, tandis qu’elle dansait ainsi, au bourdonnement du tambour de basque que ses deux bras ronds et purs élevaient au-dessus de sa tête, mince, frêle et vive comme une guêpe, avec son corsage d’or sans pli, sa robe bariolée qui se gonflait avec ses épaules nues, ses jambes fines que sa jupe découvrait par moments, ses cheveux noirs, ses yeux de flamme, c’était une surnaturelle créature. – En vérité, pensa Gringoire, c’est une salamandre2, c’est une nymphe3, c’est une déesse, c’est une bacchante4 du mont Ménaléen5 ! En ce moment une des nattes de la chevelure de la « salamandre » se détacha, et une pièce de cuivre jaune qui y était attachée roula à terre. – Hé non, dit-il, c’est une bohémienne. Toute illusion avait disparu. Victor Hugo, Notre-Dame
de Paris (1831), Livre II, chapitre III. 1. Philosophe partisan du doute systématique. |
1. Un portrait fondé sur le réel : – La beauté d’Esméralda est toute de finesse (sa fine taille ; petit pied ; mince, frêle ; ses jambes fines), et elle est encore soulignée par de nombreux termes mélioratifs (éblouissante, ce beau reflet doré, sa gracieuse chaussure, sa rayonnante figure). Esméralda est l’archétype de la beauté exotique : elle est comparée à une Andalouse ou à une Romaine, Hugo insiste sur la noirceur de ses cheveux (Elle était brune ; ses cheveux noirs) qui tranchent avec son regard de braise (ses grands yeux noirs vous jetaient un éclair ; ses yeux de flamme). Sa tenue est également exotique pour un homme du XIXe siècle, avec sa robe bariolée, son tambour de basque, ainsi que le vieux tapis de Perse. – Esméralda présente une puissance érotique largement soulignée par le regard qui la déshabille (on devinait que le jour sa peau devait avoir ce beau reflet doré des Andalouses et des Romaines). Ce regard s’attarde successivement sur ses deux bras ronds et purs, sur les seins qui gonflent son corsage (son corsage d’or sans pli), sur ses épaules nues, ses jambes fines que sa jupe découvrait par moments. – En outre il s’agit d’une sorte d’oxymore vivant réunissant en elle les contraires (Son petit pied […] était tout ensemble à l’étroit et à l’aise). L’anaphore de « mais » souligne le paradoxe du personnage (Elle n’était pas grande mais elle le semblait […] Elle était brune, mais on devinait que le jour sa peau devait avoir ce beau reflet doré). Elle est à la fois nuit et lumière (chaque fois qu’en tournoyant sa rayonnante figure passait devant vous, ses grands yeux noirs vous jetaient un éclair… ses cheveux noirs, ses yeux de flamme), opposition éminemment hugolienne… 2. La transfiguration de la réalité : – Ce regard indiscret qui se porte sur Esméralda est exprimé à la fois par focalisation interne et externe, de sorte que ce refus d’un narrateur omniscient permet d’installer une hésitation sur la nature de cette jeune fille : – focalisation interne : la scène est vue par les yeux de Gringoire qui ignore l’identité d’Esméralda (une jeune fille dansait). Son jugement est exprimé soit au discours direct (En vérité, pensa Grégoire, c’est une salamandre, c’est une nymphe, c’est une déesse, c’est une bacchante du mont Ménaléen), soit au discours indirect libre (Son petit pied aussi était andalou). – focalisation externe : la scène est vue également par la foule (tous les regards étaient fixes, toutes les bouches ouvertes), mais aussi par le lecteur lui-même qui devient l’un des spectateurs fascinés (chaque fois qu’en tournoyant sa rayonnante figure passait devant vous, ses grands yeux noirs vous jetaient un éclair). – La beauté d’Esméralda est d’abord identifiée en une gradation méliorative (un être humain, ou une fée, ou un ange) ; les verbes se succèdent en asyndète pour essayer de saisir cette créature, là aussi en une gradation (elle dansait, elle tournait, elle tourbillonnait). La focalisation interne à travers les yeux du poète Gringoire permet de poétiser cette description : fasciné, cet intellectuel fait appel à sa culture littéraire pour identifier cette éblouissante vision (le mot vision a une connotation fantastique qui sera confirmée par surnaturelle créature, contribuant à en faire un personnage inquiétant) : la seconde série d’identifications est faite d’hésitations érudites , soulignées par des anaphores (c’est une salamandre, c’est une nymphe, c’est une déesse, c’est une bacchante du mont Ménaléen). – On note une nette évolution puisque, à la fée et à l’ange, succèdent des êtres un peu moins rassurants, comme la bacchante et sa folie dionysiaque. Esméralda trouble Gringoire, à cause de son animalité : le bourdonnement du tambour prépare subtilement la comparaison avec une guêpe, à la fois pour sa taille fine, mais aussi pour son caractère inquiétant ; de même la salamandre (le terme est répété avec insistance par Hugo) a partie liée avec le feu et dans l’imaginaire médiéval peut-être avec l’Enfer. Réflexion sur le rôle de l’artiste : – La chute finale (Toute illusion avait disparu) souligne la séparation radicale entre la réalité et sa transfiguration poétique : Gringoire (dont Hugo souligne à l’envi le ridicule, tant dans son enthousiasme pédant, que dans sa déconvenue finale) est victime de ses préjugés : Hé non, dit-il, c’est une bohémienne. Ce philosophe sceptique, ce poète ironique ne voit pas plus loin que le bout de son désir ; la pièce de cuivre jaune, avec son métal vil, semble une métaphore de la chute d’Esméralda dans l’estime de Gringoire. – Cette figure caricaturale du poète dessine en négatif celle de Victor Hugo : le mystère de Gringoire, qui a connu un échec retentissant, semble l’inverse du triomphe d’Hernani quelques mois plus tôt. Le mépris de Gringoire pour la bohémienne contraste avec l’attitude d’Hugo qui prendra toujours la défense des « femmes de mauvaise vie », que ce soit dans Les Chants du crépuscule en 1835 (« Oh ! n’insultez jamais une femme qui tombe ! »), ou plus tard dans les Misérables avec Fantine. – A la vilénie des deux personnages emblématiques de l’Eglise (avec Frollo) et de la noblesse (avec Phœbus) qui, comme Gringoire, ne verront jamais en Esméralda qu’un corps désirable, répond la simplicité de l’amour pur avec Esméralda et Quasimodo. Dès Notre-Dame de Paris, Hugo se fait le champion des réprouvés, car l’artiste se doit d’œuvrer pour le progrès social. |