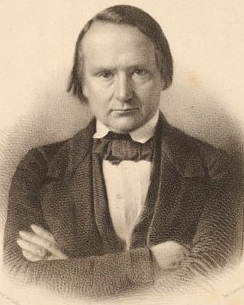|
|
Oh
! n’insultez jamais une femme qui tombe ! Qui
sait sous quel fardeau la pauvre âme succombe ! Qui
sait combien de jours sa faim a combattu ! Quand
le vent du malheur ébranlait leur vertu, Qui
de nous n’a pas vu de ces femmes brisées S’y
cramponner longtemps de leurs mains épuisées ! Comme
au bout d’une branche on voit étinceler Une
goutte de pluie où le ciel vient briller, Qu’on
secoue avec l’arbre et qui tremble et qui lutte, Perle
avant de tomber et fange après sa chute ! La
faute en est à nous. A toi, riche ! à ton or ! Cette
fange d'ailleurs contient l’eau pure encor. Pour
que la goutte d’eau sorte de la poussière, Et
redevienne perle en sa splendeur première, Il
suffit, c’est ainsi que tout remonte au jour, D’un
rayon de soleil ou d’un rayon d'amour ! 6
septembre 1835 Les Chants du crépuscule (1835) |
|
|
___________________________________
|
La
littérature a souvent eu au cours des âges des rapports étroits avec la société
où vivaient les auteurs, car l’artiste ne se conçoit plus alors comme un être
à part, mais au contraire comme un homme auquel rien de ce qui est humain ne
saurait être étranger. Le XIXe siècle, à cet égard, est un siècle
tourmenté et foisonnant, riche en événements politiques qui ont été propices
à l’émergence de l’écrivain engagé : qu’on songe par exemple au
« J’accuse » de Zola. Victor Hugo, maître incontesté du romantisme,
semble dominer ce siècle agité de son immense stature : romancier (Notre-Dame
de Paris, Les Misérables, Les Travailleurs de la mer),
poète (Les Orientales, Les Feuilles d’automne, Les Chants du
crépuscule, Les Voix intérieures,
Les Contemplations, La Légende des siècles), dramaturge
(Hernani, Ruy Blas),
il est également un homme politique dont l’engagement le conduira à un exil
de vingt ans pour protester contre le coup d’état de Napoléon III qu’il
fustigera dans les Châtiments. En 1835, cinq ans après la fameuse
bataille d’Hernani, Hugo publie un recueil poétique, Les Chants du
crépuscule, dans lequel s’affirme déjà sa volonté de défendre les droits
de l’homme. Ainsi dans le poème « Oh ! n’insultez jamais une femme qui
tombe ! », il entend dénoncer la condition des prostituées. Mais comment
plaider la cause de femmes que tous méprisent à son époque ? Nous
verrons que le poète suscite d’abord la pitié de son lecteur en
recourant au registre pathétique, puis qu’il passe au registre polémique pour
s’en prendre aux responsables de cette misère ; enfin nous examinerons
comment Hugo donne une dimension religieuse à son propos. L’émotion
avec laquelle le poète s’exprime est immédiatement perceptible à la
ponctuation : presque toutes les phrases du poème sont exclamatives, et
cette manière d’afficher son émotion concourt à la faire partager par le
lecteur qu’il apostrophe avec vivacité dès le premier vers (Oh !
n’insultez jamais une femme qui tombe !). Par ailleurs, la structure
rythmique de la première strophe repose sur l’utilisation d’une cadence
majeure : d’abord trois phrases d’un vers chacune, puis une phrase de
trois vers, et enfin une phrase de quatre vers. Ainsi le rythme des phrases,
en se déployant, s’accorde avec la montée de l’émotion. Le
mot « prostituée » n’est jamais prononcé, car Hugo préfère procéder
par allusions, afin de décrire ces créatures, que la société condamne
unanimement, non pas comme des fautives, mais comme des victimes de cette
même société. Ainsi le poète désigne ces femmes brisées qui vendent
leur corps par l’expression pauvre âme, qui évoque au contraire la
spiritualité et appelle la compassion du lecteur. Ces femmes n’ont pas choisi
leur déchéance, celle qui succombe est innocente, elle n’est en fait
que la victime passive du malheur. Bien
plus, Hugo rappelle à quel point au contraire elles ont dû lutter (Qui
sait combien de jours sa faim a combattu !), il les dépeint comme
écrasées par le fardeau d’une misère trop grande pour elles. Et malgré
cela, malgré ce combat inégal et perdu d’avance, ces femmes continuent
pourtant à se cramponner longtemps de leurs mains épuisées. Là où les
autres voient de la faiblesse et du vice, Victor Hugo voit donc au contraire
du courage et de la vertu : l’image du vent du malheur leur
confère même une grandeur tragique, en les montrant vaincues par une force
supérieure contre laquelle elles ne peuvent rien. On notera d’ailleurs
qu’hormis la mention des femmes brisées, Victor Hugo n’utilise que le
singulier, ce qui a pour effet de souligner l’isolement et la faiblesse de
chaque individualité. Par
ailleurs, le poète use au long du poème d’une métaphore filée qui insiste sur
la fragilité de ces femmes : « Comme au bout d’une branche on
voit étinceler/ Une goutte de pluie », « Perle »,
« goutte d’eau », « perle ». Cette image
connote à la fois l’humilité (une goutte d’eau, ce n’est rien du tout) et la
pureté : ces femmes, même abaissées, même méprisées et honnies par la
société, ces femmes dont le corps est souillé par la misère conservent encore
en elles leur âme restée pure : Cette fange d'ailleurs contient l’eau
pure encor. En outre, la répétition du mot mélioratif perle tend à
réhabiliter ces pauvresses : cette métamorphose de la boue en perle
rappelle les vieux contes d’autrefois, on n’est pas loin de l’image de
Cendrillon. Ainsi
le poète suscite l’émotion du lecteur, il fait en sorte de changer son regard
et de l’amener à reconsidérer ses préjugés moraux. Mais cela n’est pas le
seul but de Victor Hugo : pour remédier à cette situation, il se doit
aussi d’en dénoncer les coupables. En
effet, loin de se contenter d’apitoyer, le poète entend également révolter
son lecteur et lui faire partager son indignation. A cet égard le premier
vers de la seconde strophe montre bien sa démarche. On aurait pu s’attendre à
un manichéisme facile, on aurait pu s’attendre à ce que Victor Hugo se pose
en donneur de leçons, mais il n’en est rien : « La faute en est
à nous », nous sommes tous coupables parce que nous laissons faire
cela, et le poète estime avoir lui aussi sa part de responsabilité. La cause
en est notre indifférence (Qui de nous n’a pas vu de ces femmes brisées),
voire, ce qui est pire, le mépris dont sont victimes les prostituées (Oh !
n’insultez jamais une femme qui tombe !). Et l’anaphore de « Qui
sait » souligne à quel point les gens bien-pensants condamnent sans
savoir. Mais
cette attitude de condamnation et de rejet n’est que la conséquence d’un état
de la société contre lequel le poète s’insurge et dont cette fois-ci il se
désolidarise : le second hémistiche du premier vers de la seconde
strophe montre en quelque sorte l’autre versant de la responsabilité :
« A toi, riche ! à ton or ! ». L’apostrophe désigne
clairement le coupable et les causes de la prostitution : c’est la
cupidité et l’avarice du riche, ce sont les inégalités sociales scandaleuses
qui poussent ces femmes à se vendre quand la faim les torture. Ainsi
la branche qu’on secoue pour faire tomber la goutte de pluie est
l’image de ce cruel harcèlement de la société, ce « on »
impersonnel qui est la figure de la fatalité moderne. Contre le règne de
l’argent on ne peut rien, et la polysyndète « et qui tremble et qui
lutte » souligne le pathétique de ce vain combat, fait de peur et
d’énergie désespérée. Toutefois
Victor Hugo ne se contente pas de dénoncer le sadisme d’une société
injuste : il propose une solution, une solution toute simple :
l’amour, vertu chrétienne s’il en est. Et l’on perçoit alors pourquoi ce
poème présente une dimension religieuse aussi importante. Les
prostituées étaient (et sont) considérées comme des pécheresses, vouées à la
damnation éternelle. Or toute la force de ce poème est qu’il rappelle aux
hommes le message du Christ, un message d’amour ET d’espoir. La déchéance de
la femme qui succombe au péché est présentée comme une chute (« une
femme qui tombe », « Perle avant de tomber et fange après sa
chute »), et l’image de la chute renvoie clairement dans la
tradition biblique au péché originel. Or la structure du poème nous invite à
y voir après le récit d’une chute (première strophe) le rachat du péché et la
renaissance par l’amour (seconde strophe) : ce n’est pas un hasard si le
dernier mot de la première strophe est le mot chute, et si le dernier
mot du poème est amour. Selon
la tradition catholique, le Christ a été le seul à comprendre la pécheresse
que tous condamnaient et à lui pardonner ses péchés. Victor Hugo ne fait pas
autrement, et il invite ses lecteurs à dépasser leurs préjugés et à retrouver
le message d’amour du Christ. Par le jeu du champ lexical de la lumière il
établit un lien entre la femme comparée à une goutte de pluie qu’au bout
d’une branche on voit étinceler, et le ciel qui vient briller
dans cette goutte de pluie. Cette métaphore de la lumière de l’amour divin
est reprise dans le dernier vers du poème qui, dans un parallélisme, fait se
correspondre le rayon de soleil et le rayon d’amour. Mais cet
amour auquel Hugo nous convie doit venir de nous : nous devons cesser de
mépriser et de condamner des femmes qui ne sont que des victimes de la
société. Ainsi,
à l’instar du Christ rédempteur, un seul regard d’amour de notre part peut
rendre la vie à ces femmes. Là encore le mot fange est nettement
symbolique, car il connote la souillure morale (qu’on songe aux fameux vers
de « Booz endormi » : « Il n'avait pas de fange en
l'eau de son moulin ; / Il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge »).
Au thème de la fange, Victor Hugo associe l’idée que l’homme a été créé par
Dieu à partir de la poussière (« Car tu es poussière et tu retourneras à
la poussière » dit la Bible). Cette combinaison des deux thèmes suggère
donc que pour que pour que la goutte d’eau sorte de la poussière, pour
que la femme souillée revienne à la vie sociale et retrouve sa splendeur
première, il suffit d’un peu de chaleur humaine et d’un regard d’amour (D’un
rayon de soleil ou d’un rayon d'amour). C’est
donc un message d’amour et d’espoir que délivre Victor Hugo dans ce
poème ; en jouant sur les registres pathétique et polémique, il fait en
sorte de changer le regard de son lecteur sur des femmes habituellement méprisées,
en rappelant que la Charité est avec l’Espérance et la Foi l’une des trois
vertus théologales du christianisme. Victor Hugo restera toujours fidèle à
ses idéaux : bien des années après, dans les Misérables, il
reprendra à nouveau la défense des femmes du peuple que la misère contraint à
se prostituer, avec la figure de la petite Cosette et de sa maman Fantine, devenue prostituée pour nourrir son enfant… |