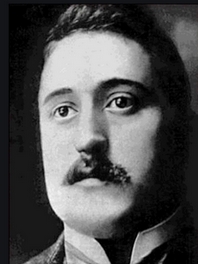|
|
(1880-1918) |
Le Pont Mirabeau Sous le pont Mirabeau
coule la Seine Et nos amours Faut-il qu’il m’en
souvienne La joie venait toujours
après la peine Vienne la nuit sonne
l’heure Les jours s’en vont je
demeure Les mains dans les mains restons face à face Tandis que sous Le pont de nos bras passe Des éternels regards
l’onde si lasse Vienne la nuit sonne
l’heure Les jours s’en vont je
demeure L’amour s’en va comme
cette eau courante L’amour s’en va Comme la vie est lente Et comme l’Espérance est
violente Vienne la nuit sonne
l’heure Les jours s’en vont je
demeure Passent les jours et
passent les semaines Ni temps passé Ni les amours reviennent Sous le pont Mirabeau
coule la Seine Vienne la nuit sonne
l’heure Les jours s’en vont je
demeure Guillaume Apollinaire, Alcools, 1913 |
|
|
Introduction |
Phrase
d’accroche : Nous allons étudier le
poème sans doute le plus célèbre d’Apollinaire Présentation de
l’auteur et de l’œuvre : Apollinaire est l'un des
poètes français les plus importants du XXe siècle par son souci de
faire entrer la poésie française dans la modernité. En tant que critique, il
fréquenta de nombreux artistes (peintres cubistes en particulier), et c’est
lui qui inventa le mot « surréalisme »
pour désigner cette forme d’art transdiciplinaire visant
à libérer l’inconscient du contrôle de la raison. Présentation du
texte : Ce poème, « Le pont
Mirabeau », est le deuxième texte d’Alcools,
un recueil de poèmes composés entre 1898 et 1913, et publiés en 1913. « Le
pont Mirabeau » succède au poème liminaire « Zone » qui
revendique une modernité radicale de la poésie (absence de ponctuation ;
vers irréguliers, proches de la prose ; thématique de la ville moderne).
Or, curieusement, ce texte semble être un retour à une forme de versification
plus classique, qui semble se présenter comme une chanson (ce poème a été mis en chanson
plusieurs fois). Apollinaire évoque sa rupture avec Marie Laurencin, une
peintre avec laquelle il eut une liaison, et évoque la fuite du temps
semblable à l'eau qui s'en va. L'eau est un thème lyrique qui
traditionnellement renvoie au passage du temps et à la fuite de
l'amour. |
|
|
lecture (2 points) |
Les quatrains
sont des décasyllabes (les vers 2 et 3 de chaque strophe étant en fait un
décasyllabe cassé : 4 + 6). Attention donc à la diérèse « vi-olente » (il faut entendre 10 syllabes à chaque
fois !). Le refrain est
au contraire en heptasyllabes (rythme impair et rare). Difficulté d’un
texte sans ponctuation : marquer une pause à la fin du premier vers. |
|
|
explication
linéaire (8 points) |
Problématique : Comment Apollinaire
renouvelle-t-il le thème traditionnel du temps assassin ? |
|
|
Plan fondé sur
le mouvement du texte : Le texte, scandé par le
retour d’un refrain en distique, comporte quatre quatrains où, après
l’évocation du pont lui rappelant son amour passé (premier quatrain), le
poète évoque la lassitude qui s’installe dans le couple (deuxième quatrain),
puis la fuite de l’amour (troisième quatrain), et enfin la fuite du temps qui
laisse cet amour dans un passé inaccessible (quatrième quatrain). |
|
|
|
Explication
linéaire : L’évocation du pont lui rappelle son amour passé : Le
pont Mirabeau est à l’époque un ouvrage moderne, et il continue la recherche
de modernité de « Zone ». Le pont Mirabeau, situé à Auteuil, était
emprunté par le poète lorsqu'il rentrait de chez Marie Laurencin. Apollinaire
mêle donc ici un souvenir personnel et une volonté de modernité. Les
quatrains sont en fait des tercets à la base (voir le manuscrit) : les
vers 2 et 3 de chaque strophe sont en fait un décasyllabe coupé en deux (4 + 6).
Il s’agit là encore d’une volonté de donner une forme moderne à la poésie, avec
le choix de casser le rythme traditionnel des décasyllabes, ce qui a chaque
fois crée une rime orpheline. L’absence
de ponctuation fait hésiter à dessein sur la construction de la phrase :
faut-il lire « Sous le pont
Mirabeau coule la Seine Et nos amours » (dans une rupture de
construction en hyperbate), ou bien « Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours, Faut-il qu’il
m’en souvienne ». L’accord du verbe, le manuscrit et l’enregistrement
audio d’Apollinaire lui-même montrent qu’il s’agit de la deuxième solution.
Mais cette ambiguïté associe dès le début du poème l’amour à la Seine qui
passe. Cet
amour orageux trouvait son équilibre en quelque sorte dans une compensation
de la peine par la joie. Dans cette antithèse, la joie est présentée dans le
vers en première position alors qu’elle vient après (« La joie venait toujours après la peine ») :
c’est déjà pour le poète une tentative de remonter vers un passé heureux. Le mètre choisi pour le
distique, l’heptasyllabe, montre là aussi une volonté de modernité héritée de
l’ « Art poétique » Verlaine (« De la musique avant toute chose, / Et pour cela préfère l'Impair /
Plus vague et plus soluble dans l'air »). Cette sorte de refrain oppose un souhait (avec deux
subjonctifs « vienne, sonne »
= « que vienne la nuit, que sonne l’heure ») à la réalité de l’indicatif
« Les jours s’en vont je demeure ». Le
parallélisme de construction « Vienne
la nuit sonne l’heure » associe le temps qui passe inexorablement à
la nuit, symbole habituel de la vieillesse ou de la mort ; à cette nuit s’opposent
les jours, lesquels sont opposés à leur tour au « je » du poète :
dans ce monde héraclitéen
en perpétuel mouvement où tout coule, tout passe, seul le poète « demeure ». Sa fixité le condamne
donc à un abandon progressif. La lassitude qui s’installe dans le couple : Le
poète tente alors de restaurer ce qui fut un couple, par l’emploi de la 1ère
personne du pluriel « restons »,
« nos bras », par la
répétition deux par deux de « Les mains dans les
mains… face à face ». Mais ce fragile équilibre
est immédiatement brisé, comme le décasyllabe qui suit, avec une cassure (« Tandis que sous… le pont ») qui
crée un déséquilibre dans la versification. Au pont Mirabeau du premier
quatrain succède la métaphore « Le
pont de nos bras », dérisoire tentative de recréer un lien. Mais à la Seine succède à
son tour « l’onde si lasse »
des « éternels regards » :
l’éternité tant recherchée de l’amour devient une lassitude, l’échange des
regards est désormais vain, ce que souligne l’antéposition du complément de
nom « des éternels regards » :
le chiasme adjectif-nom/nom-adjectif crée une antithèse entre l’éternité de l’amour
et la lassitude de l’amour, tué par le temps qui s’écoule comme l’eau. La fuite de l’amour : A la métaphore des regards
qui coulent, succède une comparaison explicite, « L’amour s’en va comme cette eau courante ». La répétition de
« L’amour s’en va »
marque le caractère inexorable de cette perte. Le temps semble alors se
distordre puisqu’il est à la fois rapide (« eau courante ») et lent (« comme la vie est lente ») : tout s’en va, et seul le
poète, qui « demeure », essaie
de ralentir cette fuite du temps. La paronomase entre « vie est lente » et « vi-olente »
(avec diérèse) souligne le paradoxe déjà entrevu : c’est parce que le
poète essaie désespérément de s’accrocher à un amour perdu qu’il souffre. L’allégorie
de l’Espérance (peut-être empruntée au poème « Spleen » de
Baudelaire) renvoie surtout pour son sens au texte d’Hésiode, Les
travaux et les jours (v.96) : l’Espérance est le pire des maux
resté dans la « boite » de Pandore. C’est parce qu’il espère
toujours que le poète « demeure »,
qu’il ne peut pas avancer ; il espère reproduire dans l’avenir un passé
à jamais révolu. La fuite du temps laisse cet amour dans un passé inaccessible : La gradation
soulignée par le parallélisme « Passent
les jours et passent les semaines », doublé par l’anaphore
de « passent », confirme
l’échec du poète : il ne peut retourner dans le passé, de même que le
fleuve ne peut retourner à sa source (adynaton). L’anaphore
de « ni… ni… » relègue
définitivement l’amour dans un passé perdu à jamais. Les système des rimes est
le même que dans la première strophe, et la reprise du premier vers en
dernière position du quatrain « Sous
le pont Mirabeau coule la Seine » montre que le poète, englué dans
le passé (« Les jours s’en vont je
demeure »), est condamné à un perpétuel recommencement. Conclusion : Apollinaire fait
paradoxalement preuve d’originalité en recourant à un thème rebattu, celui de
la fuite du temps. Par une composition qui lie étroitement entre eux la
Seine, le temps, l’amour, le poète traite sous une forme moderne l’histoire
éternelle des amours perdues. |
|
|
|
réponse à la
question de grammaire (2 points) |
Exemples de questions (en
rapport avec la recherche du sens…) : -
Quelle est la
fonction de Seine dans « Sous le pont Mirabeau coule la Seine » ? -
Quelle est la
nature de la proposition « Tandis
que sous Le pont de nos bras passe Des éternels regards l’onde si lasse » ? |