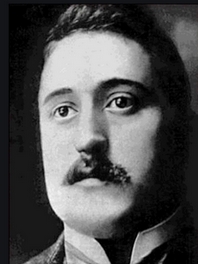|
(1880-1918) |
Nuit rhénane Mon verre est plein d’un vin
trembleur comme une flamme Écoutez la chanson lente d’un
batelier Qui raconte avoir vu sous la
lune sept femmes Tordre leurs cheveux verts et
longs jusqu’à leurs pieds Debout chantez plus haut en
dansant une ronde Que je n’entende plus le chant
du batelier Et mettez près de moi toutes les
filles blondes Au regard immobile aux nattes
repliées Le Rhin le Rhin est ivre où les
vignes se mirent Tout l’or des nuits tombe en
tremblant s’y refléter La voix chante toujours à en
râle-mourir Ces fées aux cheveux verts qui incantent l’été Mon verre s’est brisé comme un
éclat de rire |
|
Introduction : Le poème « Nuit rhénane » ouvre le cycle des 9 poèmes de
la section « Rhénanes », inspirée par le voyage d’Apollinaire en
Allemagne et sa rencontre avec une jeune anglaise, Annie Playden. Dans cette section, Apollinaire s’inspire de divers
mythes germaniques et introduit dans sa poésie les figures surnaturelles des
nixes du Rhin, femme fascinantes et dangereuses qui, dans sa vie personnelle,
lui rappelle sa fascination pour Annie Playden. |
|
Lecture (2 points) |
|
Problématique : Comment Apollinaire tente-t-il de renouveler la poésie ? |
|
Plan fondé sur le mouvement du texte : Le poète évoque d’abord dans la première strophe la
tradition de la mythologie germanique (1), puis il veut y substituer une
autre forme de poésie (2), mais il échoue finalement (3), et le dernier vers
est un constat d’échec. |
|
1ère strophe : Le poète se met immédiatement en scène avec l’adjectif
possessif « mon ». L'ivresse du poète semble l’origine de
l’écriture du poème (le poème s'ouvre et se ferme sur le verre de vin, vers 1
et 13). Le premier vers suggère doublement cette idée de l’inspiration
associée à une perte de soi : par l'image du « vin trembleur » qui
trouble la vision (et non « tremblant » : ici c’est le vin qui
fait trembler le poète), et par la comparaison, où Apollinaire rapproche le
vin d'une flamme insaisissable et mouvante. Or la flamme est aussi
traditionnellement la métaphore de l’inspiration poétique (Du Bellay
« Cette honnête flamme au peuple non commune », Les regrets,
VI) : le poème est aussi et surtout une réflexion sur la poésie. L’impératif du 2e vers « Ecoutez »
prend à témoin les autres personnes présentes dans cette taverne au bord du
Rhin, mais aussi le lecteur du poète. La chanson lente du batelier que
le poète nous invite à écouter renvoie à la poésie romantique et en
particulier, de toute évidence, au célèbre poème de Heinrich Heine « La
Loreleï » : la figure du batelier
rappelle que ces femmes aux cheveux verts sont des nixes, des sortes de
sirènes qui font naufrager les marins attirés par leur chant. Apollinaire est
donc visiblement tenté par ce type de poésie mélancolique, suggérée par
l’adjectif lente. Le chiffre sept a une signification symbolique,
puisqu’il est traditionnellement réputé magique (voir Septénaire). Ces sept femmes
sont donc inquiétantes, d’autant qu’elles sont dépeintes de manière assez
violente, dans leur façon de tordre leurs cheveux verts. 2e strophe : L’impératif Debout, chantez plus haut marque une
réaction de rejet de la part du poète, une résistance : à la chanson
lente et mélancolique qu’il ne veut plus entendre, il substitue une chanson
gaie et animée, sur laquelle on peut danser une ronde. Au chant solitaire du
batelier est substitué une chant choral (= en
chœur). Les filles blondes avec leurs tresses qu’Apollinaire
réclame sont une sorte de stéréotype de la serveuse d’auberge allemande.
Elles sont surtout bien sûr l’opposé des femmes aux cheveux verts : à
l’excitation furieuse des nixes, le poète préfère leur regard immobile, aux
cheveux verts désordonnés tombant jusqu’aux pieds sont substitués de sages
nattes repliées. Les deux impératifs chantez et mettez
associent la chanson gaie à ces filles rassurantes, en contraste total avec
la chanson mélancolique du batelier et les nixes inquiétantes. 3e strophe Le motif de l'ivresse est projeté dans le paysage
lui-même : le Rhin personnifié est « ivre » comme le poète, et les vignes qui
se mirent dans son eau sont une sorte de mise en abyme du poète lui-même se
projetant dans ce paysage. La répétition de Le Rhin le Rhin, outre
qu’il suggère que dans son ivresse le poète est tenté de se jeter dans le
Rhin et de s’y perdre comme les bateliers, laisse entendre par l’allitération
(LRL) le nom même de Loreleï, allitération confirmée par une autre allitération où
le mot IVRe se retrouve dans les VIgnes se mIRent. Sous l’effet de l’ivresse le paysage chavire : la
lune et les étoiles, désignées par la métaphore Tout l’or des nuits,
se reflètent dans le fleuve, et renvoient au début du poème (la lune du v.
3). En tremblant renvoie aussi
au vin trembleur du v.1 : le vin blanc du Rhin, qui était
évoqué par l’image la flamme, se retrouve aussi dans l’or des nuits,
l’ivresse envahit tout le paysage et le déforme. Le déséquilibre est aussi
suggéré par le rythme ternaire (Tout l’or des nuits / tombe en tremblant / s’y
refléter) qui vient briser le rythme jusque là régulier des
alexandrins. La tentative de couvrir le chant du batelier s’avère
vaine : la voix chante toujours, et le néologisme d’Apollinaire râle-mourir
associe cette forme de poésie à l’agonie de la mort, mort annoncée par la
présence des nixes. Le poète comme le marin échoue, si bien qu’à la fin ce
n’est plus le chant du batelier que l’on entend, mais le chant magique de ces
fées aux cheveux verts qui est une incantation, c’est-à-dire une formule
magique (récitée, psalmodiée ou chantée) qui est censée ensorceler un être
vivant. Le dernier vers, détaché, souligne le caractère
dérisoire de la tentative de faire une poésie détaché du lyrisme romantique.
Le poète joue sur l’homophonie entre verre, vert et… vers : cette
poésie, née de l’ivresse et d’une vision hallucinatoire des nixes, tourne en
rond et reprend la structure du début (Mon verre… comme… → Mon verre… comme…). Ce vers isolé empêche
de voir dans ce texte un sonnet : il manque un dernier vers… le vers s’est brisé, et tout cela
n’était finalement qu’un jeu littéraire introduisant une remise en question
de la poésie traditionnelle (avec un sonnet tronqué, un peu à la manière du
sonnet inversé de Tristan Corbière « Le crapaud ») là où le poète
donne à voir l’échec d’une forme de poésie nouvelle… Conclusion : Apollinaire essaie de couper radicalement avec
l’ancienne poésie (la chanson du batelier) mais c’est un échec partiel :
Apollinaire ne revendique pas la modernité comme une rupture, mais comme une
continuation, il ne peut pas se passer du lyrisme romantique. |
Autre approche :