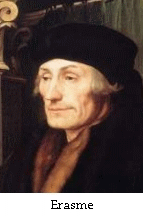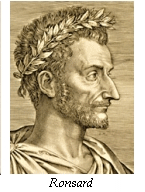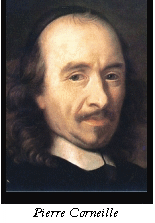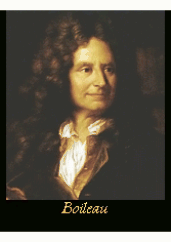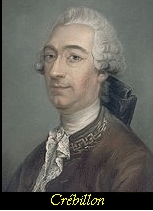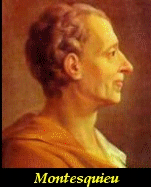Petit panorama d’histoire littéraire
Ce « petit panorama » vise juste à un peu de
clarté et n’entend nullement être exhaustif. Chaque mouvement littéraire est
d’abord décrit sommairement, avec la mention des écrivains les plus
représentatifs. On constatera que les mouvements littéraires ne sont pas des
boîtes dans lesquelles on peut caser n’importe quel auteur : on a du
mal à enfermer certains auteurs dans des boîtes.
Puis dans une « chronologie sommaire » sont présentées les
grandes œuvres, situées dans leur époque (avec en particulier la mention de
l’autorité politique en place), avec les « incontournables » signalés
en jaune, et quelques extraits ou études.
Enfin, la dernière colonne du tableau entend rappeler que, derrière tous ces textes, il y avait des hommes de chair et de sang qui nous parlent par-delà les siècles : les quelques illustrations et indications diverses (sur la mode, les arts, etc.) entendent juste rendre un visage et un corps à des textes souvent trop désincarnés.
|
|
littérature
|
CHRONOLOGIE
sommaire
( |
Iconographie,
etc.
|
|
La prise de Constantinople par les Turcs et l’invention de l’imprimerie permettent une large diffusion des textes de l'Antiquité. La littérature antique est considérée comme un trésor qu’il faut étudier et assimiler (soif de savoir). Les différences et les points communs avec l’Antiquité amènent à une réflexion sur ce qu’est l’Homme. Enthousiasme, recherche du bonheur par la connaissance. Mais le retour aux textes antiques va aussi déboucher sur les guerres de religion… Les auteurs principaux : Erasme, François Rabelais, Michel de Montaigne, Etienne de La Boétie, Agrippa d’Aubigné, Guillaume Budé, Etienne Dolet, Louise Labé Les genres littéraires principaux : Poésie, essais, récits, traductions. |
–
1511 :
Erasme, Eloge
de la folie. –
1515-1547 : règne de François Ier –
1516 : Thomas More, L’Utopie. –
1532 :
Rabelais, Pantagruel. –
1534 : Rabelais, Gargantua. z –
1546 :
Rabelais, Le Tiers
livre –
1547 – 1559: règne de Henri II –
1549 : La
Boétie, Discours de la servitude volontaire. –
1549 :
Du Bellay : Défense et illustration de la langue française.
–
1549
– 1550 : Du Bellay : L'Olive. z –
1550 :
Du Bellay : L'Olive, second recueil. –
1550 :
Ronsard : Odes, Livres I à IV. z –
1552 : Rabelais, Le Quart livre z –
1552 :
Ronsard : Amours.
z –
1553 :
Jodelle, Cléopâtre captive ; l’Eugène. –
1555
– 1556 : Ronsard : Hymnes
–
1558 :
Du Bellay : Les
Regrets –
1559-1560 : règne de François II –
1559 :
Du Bellay : Le Poète courtisan. –
1560 – 1564 : régence de Catherine de
Médicis –
1560 :
Ronsard : première édition des Œuvres. –
1562 :
Ronsard : Discours sur les misères de ce temps. –
1564 – 1574 : règne de Charles IX –
1565 :
Ronsard : Élégies, mascarades et bergeries. –
1571 :
Agrippa d’Aubigné, Le Printemps. –
1572 :
Ronsard : La Franciade, Livres I à IV. –
1573 :
Baïf, Les Passe-Temps –
1574 – 1589 : règne d’Henri III –
1574 :
Étienne Jodelle : Œuvres, édition posthume. –
1578 :
Ronsard : Sonnets
pour Hélène. z, z –
1580 : Montaigne,
Les Essais. –
1586 :
Ronsard : Derniers vers. –
1589 – 1610 : règne d’Henri
IV –
1616 :
Agrippa d’Aubigné, publication tardive des Tragiques. |
|
|
|
La Pléiade : Menés par Ronsard, leur chef de file incontesté, les sept membres de la Pléiade sont des Humanistes, qui imitent librement les auteurs grecs et latins, afin d’enrichir la langue française. Du Bellay expose leur programme dans Défense et Illustration de la langue française. Il s’agit de s’imprégner des œuvres de l’Antiquité par une lecture directe et régulière des textes en grec ou en latin (enseignement de Dorat), puis après cette « innutrition », renouveler une langue française trop pauvre et créer une littérature savante et novatrice. Ils explorent tous les genres littéraires et imposent l’alexandrin, l’ode et le sonnet. Les auteurs principaux : Pierre de Ronsard, Joachim du Bellay, Jacques Pelletier du Mans, Rémy Belleau, Antoine de Baïf, Pontus de Tyard, Étienne Jodelle
(Jean Dorat à la mort de Pelletier
du Mans) Les genres littéraires principaux : Poésie, essais, théâtre |
|
||
|
Après l’échec de l’Humanisme dans les guerres de religions, le baroque traduit une crise dans un monde en métamorphose (contacts avec l’Amérique, invention de la boussole, Copernic et de Galilée qui prouvent que la terre n'est pas au centre de l'univers). Cette
perte de repères explique les thèmes du baroque : l’instabilité et la
vanité des choses humaines, la mort (les
"vanités"),
les illusions trompeuses, le mélange des contraires, l’exubérance des
sentiments. Stylistiquement, les textes baroques sont souvent surchargés de figures de style (métaphores, hyperboles). Le burlesque, avec son côté « décalé » rencontre aussi un grand succès. Les auteurs principaux : Pierre
Corneille, Jean de Sponde, Théophile de Viau, Tristan
l’Hermite, Marc-Antoine Girard de Saint-Amant Les genres littéraires principaux : Poésie,
théâtre |
–
1588 :
Jean de Sponde, Méditations sur les Psaumes –
1597 :
Jean de Sponde, Les sonnets sur la mort z –
1607 : Malherbe, Consolation à M. du Perier sur la mort
de sa fille z –
1610-1643 : règne de Louis XIII –
1621 :
Théophile de Viau, Les Amours tragiques de Pyrame et Thisbé –
1631 :
Saint-Amant, Le Paresseux z –
1633 :
Tristan l’Hermite, Les Plaintes d’Acante z –
1635 : création de l’Académie Française. –
1636 :
Corneille, L’illusion comique z –
1637 : Corneille, Le Cid –
1637 : Descartes, Discours de la Méthode –
1643-1715 : règne de
Louis XIV –
1645 : Molière, Le Médecin volant –
1647 : Vaugelas, Remarques sur
la langue française, utiles à ceux qui veulent bien parler et bien écrire –
1656-1657 : Pascal, Les Provinciales –
1659 : Molière, Les Précieuses ridicules –
1660 : La Fontaine, Elégie aux nymphes de Vaux –
1662 : Molière, L’école
des femmes –
1664 : Molière, Tartuffe ou l’Imposteur –
1665 : Molière, Dom Juan –
1665 : La Rochefoucauld, Maximes –
1666 : Molière, Le Misanthrope ; Le Médecin malgré
lui –
1666 : Boileau, Les Satires –
1666 : Furetière, Le
Roman bourgeois –
1667 : Racine, Andromaque –
1668 : La Fontaine, Les
Fables –
1668 : Molière, L’Avare –
1669 : Racine, Britannicus –
1669 : La Fontaine, Les amours de Psyché et Cupidon –
1669 : Bossuet, Oraison funèbre d’Henriette de France –
1670 : Racine, Bérénice –
1670 : Molière, Le Bourgeois gentilhomme –
1670 : Pascal, Les Pensées (posthume) –
1670 : Bossuet, Oraison funèbre d’Henriette-Anne d’Angleterre
–
1671 : Molière, Les Fourberies de Scapin –
1673 : Molière, Le Malade imaginaire –
1674 : Boileau, Art Poétique –
1674 : Racine, Iphigénie –
1675-1677 : cardinal de Retz, Mémoires (publiés en
1717) –
1678: Mme de La Fayette, La princesse de Clèves –
1678 : La Rochefoucauld, dernière édition des Maximes –
1678 : La Fontaine, Les
Fables –
1680 : Richelet, Dictionnaire françois –
1687-1694 : querelle des Anciens et des Modernes –
1687 :
Fontenelle, Histoire des oracles –
1688 :
La Bruyère, Les
Caractères –
1690 : Furetière,
Dictionnaire universel –
1691 : Racine, Athalie –
1693 : La Fontaine, Les
Fables –
1694 : début de la rédaction des Mémoires de
Saint-Simon z –
1697:
Perrault, Contes de ma mère l’Oye –
1697 :
Bayle, Dictionnaire
historique et critique |
|
|
|
Le
classicisme se développe en France dans la deuxième moitié du XVIIe
siècle. Réaction
contre les excès du baroque, le classicisme trouve surtout sa source
principale dans un pouvoir politique centralisateur et autoritaire
(absolutisme) incarné par Louis XIV dont le règne est le plus long de
l’histoire. Diverses académies, des traités, des arts poétiques codifient les
pratiques littéraires. Le
classicisme est un ensemble de valeurs qui visent un idéal incarné dans
l’« honnête homme » et qui développent une esthétique ayant pour
but la perfection. On recherche l’ordre, l’équilibre, l’harmonie, la maîtrise
de soi par l’exercice de la raison. Pour
cela, il faut imiter
les auteurs de l’Antiquité ; la recherche du naturel se fait à
travers un ensemble de règles très strictes (règle des trois unités au
théâtre). Pour donner l'impression de naturel, il importe de ne pas choquer
le lecteur : c'est pourquoi les règles de vraisemblance et de
bienséance sont fondamentales. Les auteurs principaux : Malherbe, Boileau,
Bossuet, Mme de Sévigné Les genres littéraires principaux : Poésie, théâtre, romans, essais, discours etc. |
|
||
|
Succédant
à l’austérité de la fin du règne de Louis XIV, la Régence voit
la noblesse se tourner à nouveau vers les plaisirs. Parallèlement
aux « Lumières », le mouvement libertin affirme son opposition aux dogmes chrétiens et revendique la liberté morale de l’homme. Les
auteurs vantent alors la recherche libre du plaisir, débarrassé du carcan de
la morale chrétienne. Les
auteurs principaux : Crébillon, Sade, Laclos,
l’abbé Prévost Les genres littéraires principaux : Roman |
–
1715-1723 : Régence –
1720 : Marivaux, Arlequin
poli par l’amour –
1721 :
Montesquieu, Les Lettres Persanes –
1722 : Marivaux, La
Surprise de l’amour –
1723-1774 : règne de Louis XV –
1723 : Marivaux, La Double
Inconstance –
1724 : Marivaux, La Fausse
Suivante –
1725 : Marivaux, L’Île des
esclaves –
1728-1731 : l’abbé Prévost, Manon Lescaut –
1730 : Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard –
1732 : Voltaire, Zaïre –
1734 :
Voltaire, Les Lettres
anglaises –
1737 : Marivaux, Les
Fausses Confidences –
1736 :
Crébillon, Les Égarements du
cœur et de l'esprit –
1741 :
Marivaux, La Vie de Marianne –
1745 :
Crébillon, Le Sopha –
1746 :
Diderot, Pensées
philosophiques –
1747 :
Voltaire, Zadig –
1747-1765 : Diderot
et D’Alembert, l’Encyclopédie –
1748 :
Diderot, Les Bijoux indiscrets –
1748 :
Montesquieu, De l'esprit des lois
–
1749 :
Diderot, Lettre sur les
aveugles à l'usage de ceux qui voient –
1752 :
Voltaire, Micromégas –
1755 :
Rousseau, Discours sur l'origine et les
fondements de l'inégalité parmi les hommes –
1756 :
Voltaire, Poème sur le
désastre de Lisbonne –
1761 :
Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse –
1762 :
Rousseau, Émile ou De l'éducation –
1762 :
Rousseau, Du Contrat social z –
1763 :
Voltaire, Traité sur la
tolérance –
1764 :
Voltaire, Dictionnaire
philosophique portatif –
1765-1770 :
Rousseau, Les Confessions –
1767 :
Voltaire, L’Ingénu –
1770 :
Raynal, L’Histoire des deux
Indes –
1772 :
Cazotte, Le Diable amoureux –
1774-1792 : règne de Louis XVI –
1774 : Goethe, Die Leiden
des jungen Werther (Les Souffrances du jeune Werther)
–
1775 : Beaumarchais, Le Barbier de Séville ou la Précaution
inutile –
1776-1778 : Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire –
1776 : Diderot, Entretien
d'un philosophe avec la maréchale de *** –
1778 : Beaumarchais, La Folle journée, ou le Mariage de Figaro –
1781 : Condorcet, Réflexions
sur l’esclavage des nègres –
1782 : Laclos, Les
Liaisons dangereuses –
1787: Bernardin de Saint-Pierre, Paul
et Virginie –
1789 : Déclaration des droits de l’homme en
société z –
1791 : Sade, Justine
ou les Malheurs de la vertu –
1792-1799 : Révolution française –
1795 : Condorcet, Esquisse
d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain –
1795 : Sade, La
Philosophie dans le boudoir –
1796 : Diderot, Supplément
au voyage de Bougainville (posthume) –
1796 : Diderot, La Religieuse (posthume) –
1796 : Diderot, Jacques le Fataliste (posthume) –
1799-1804 :
Consulat de Napoléon |
|
|
|
Continuateurs
des libertins du XVIIe siècle et d’esprits critiques comme Bayle
et Fontenelle, les membres de ce mouvement, en s’engageant contre les
oppressions religieuses, morales et politiques, se voyaient comme une
élite œuvrant pour le progrès : combattant avec la « raison éclairée »
contre l’irrationnel, la superstition des siècles passés, l'arbitraire,
l'obscurantisme (auquel s’opposent « les Lumières »), ils ont renouvelé le
savoir, la morale et l’esthétique de leur temps. Née
dans les salons intellectuels, la philosophie des Lumières s'appuie sur les
découvertes scientifiques pour développer l'esprit critique et lutter
contre toutes les formes de préjugés. On remet en question le pouvoir
royal, et les principes de la démocratie et de l'égalité pour tous prennent
de l'importance à cette époque : des concepts comme la souveraineté du
peuple, la séparation des trois pouvoirs, l'abolition de l'esclavage sont nés
grâce à la philosophie des Lumières. D’une
manière générale, sur le plan scientifique et philosophique, les Lumières
voient le triomphe de la raison sur la foi et la croyance ; sur le
plan politique et économique, le triomphe de la bourgeoisie sur la
noblesse et le clergé. Ce qui
précède constitue ce que j’appellerai le « catéchisme républicain »
qu’il est de bon ton de suivre le jour du bac : la République a besoin
d’exemples à proposer à l’admiration du peuple, elle a besoin de saints laïcs
présentés comme d’ardents défenseurs des droits de l’homme etc. La
simple lecture des textes montre une réalité toute autre : Montesquieu est défenseur et théoricien de l’esclavagisme, Voltaire est antisémite et raciste, Diderot dans l’Encyclopédie considère les Noirs comme des sous-êtres proches des animaux… Si les Lumières sont sans conteste à l’origine d’un grand progrès intellectuel, moral et politique, elles ne sont en aucune façon cette vision idéalisée que nous imposent les manuels scolaires !… Les
auteurs principaux : Montesquieu, Diderot, Condorcet,
Voltaire,
Rousseau,
D'Alembert,
Beaumarchais, Marivaux Les genres littéraires principaux : Essais,
théâtre, romans |
|
||
|
Le XIXe siècle est un
siècle tourmenté et foisonnant, riche en événements politiques (Consulat >
Empire > Restauration > Monarchie de Juillet > Seconde République > Second Empire > Troisième République) et en mouvements littéraires (Romantisme, Réalisme,
Naturalisme, Parnasse, Symbolisme). Ces mouvements littéraires coexistent
souvent et se chevauchent : il n’est donc pas toujours facile de
situer tel ou tel auteur dans tel mouvement littéraire… |
|||
|
Le romantisme se développe en France sous la Restauration et la monarchie de Juillet, en réaction contre le classicisme du XVIIe siècle et le rationalisme philosophique du XVIIIe. Le préromantisme met l’accent sur une sensibilité nouvelle, très influencée par l’Angleterre (Shakespeare, Macpherson) et l’Allemagne (Schiller, Gœthe), mais surtout par Jean-Jacques Rousseau. Le romantisme privilégie le lyrisme et l'effusion du moi, souvent avec mélancolie (registre élégiaque) : on exprime le mal de vivre (« le mal du siècle ») en méditant sur la mort, la fuite du temps, sur Dieu, sur l'amour, sur une nature qui devient un miroir. Les romantiques revendiquent la liberté d’écrire en dehors des règles, afin d’être plus authentiques et plus proches de la vraie vie. Les
auteurs principaux : Chateaubriand, Mme de Staël, Senancour, Lamartine, Musset, Vigny, Hugo, Nerval, Mérimée, Dumas Les genres littéraires principaux : Poésie, théâtre, romans, essais, etc. |
–
1801 : Chateaubriand, Atala –
1802 : Chateaubriand, Le Génie
du Christianisme –
1802 : Chateaubriand, René –
1804-1815 :
Premier Empire (Napoléon 1er) –
1804 : Senancour, Obermann
–
1810 : Mme de Staël, De l’Allemagne –
1815-1830 : La
Restauration (Louis XVIII, Charles X) –
1820 : Lamartine, Les Méditations poétiques z –
1822 : Stendhal, De l’Amour –
1823 : Lamartine, Les Nouvelles Méditations –
1825 : Mérimée, Le Théâtre de Clara Gazul –
1826 : Vigny, Poèmes antiques et modernes –
1826 : Hugo, Odes et ballades –
1826 : Vigny, Cinq-Mars –
1827 : Hugo, la préface de Cromwell –
1829 : Dumas, Henri III et sa cour –
1829 : Hugo, Les Orientales –
1829-1850 : Balzac, rédaction de la Comédie Humaine –
1829 : Balzac, Les Chouans –
1829 : Hugo, Le dernier jour d’un condamné –
1829 : Musset, Contes d'Espagne et d'Italie –
1830-1848 : Monarchie de
Juillet (Louis Philippe) –
1830 : Hugo, Hernani (« la
bataille d’Hernani ») –
1830 : Stendhal, Le Rouge et le Noir –
1830 : Balzac, La Peau de chagrin –
1831 : Hugo, Les Feuilles d’automne –
1831 : Hugo, Notre-Dame de Paris –
1833 : Musset, Les Caprices de Marianne –
1833 : Balzac, Eugénie Grandet –
1834 : Musset, Lorenzaccio –
1834 : Musset, On ne badine pas avec l’amour –
1834 : Stendhal, Lucien Leuwen –
1835 : Musset, La Nuit de Mai ; La Nuit de
Décembre –
1835 : Hugo, Les Chants du crépuscule –
1835 : Vigny, Servitude et grandeur militaires –
1835 : Balzac, Le Père Goriot –
1835 : Gautier, Mademoiselle de Maupin –
1835 : Vigny, Chatterton –
1836 : Musset, La Nuit d’Août –
1836 : Musset, La Confession d’un enfant du siècle –
1836 : Balzac, Le Lys dans la vallée –
1836-1843 : Balzac, Illusions perdues –
1836 : Gautier, La Morte amoureuse –
1837 : Mérimée, La Vénus d’Ille –
1837 : Musset, La Nuit d’Octobre –
1837 : Hugo, Les Voix intérieures –
1837 : Hugo, Les Rayons et les ombres –
1838 : Hugo, Ruy Blas –
1838 : Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes
–
1839 : Stendhal, La Chartreuse de Parme –
1840 : Mérimée, Colomba –
1844 : Dumas, Les Trois Mousquetaires –
1845 : Mérimée, Carmen –
1845 : Dumas, Vingt ans après –
1845 : Dumas, La Reine Margot –
1846 : Dumas, Le Comte de Monte-Cristo –
1848-1851 : Seconde
République (Louis Napoléon Bonaparte) –
1851-1870 : Second
Empire (Louis Napoléon Bonaparte devient Napoléon III) : exil de Victor Hugo. –
1852 : Gautier, Emaux et Camées –
1852 : Leconte de Lisle, Poèmes antiques –
1854 : Nerval, Les Chimères –
1854 : Nerval, Les Filles du feu –
1856 : Hugo, Les Châtiments –
1856 : Hugo, Les Contemplations –
1857 :
Flaubert, Madame
Bovary –
1857 :
Baudelaire, Les
Fleurs du Mal –
1859-1883 :
Hugo, La Légende des
siècles –
1862 : Leconte de Lisle, Poèmes barbares –
1862 : Hugo, Les Misérables –
1862 : Flaubert, Salammbô –
1863 : Gautier, Le Capitaine Fracasse –
1864 : Vigny, Les Destinées –
1866 : Hugo, Les Travailleurs de la mer –
1866 : premier numéro du Parnasse
contemporain –
1869 : Hugo, L’Homme qui rit –
1869 : Flaubert, L’Education sentimentale –
1870-1940 : la Troisième
République –
1871-1893 : Zola, rédaction des 20 romans des Rougon-Macquart,
l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second Empire –
1871 : deuxième numéro du Parnasse
contemporain –
1874 : Hugo, Quatre-vint treize –
1875 : Hugo, Actes et paroles –
1876 : troisième numéro du Parnasse
contemporain –
1877 : Zola, L’Assommoir –
1879 : Zola, Nana –
1880 : Maupassant, Boule de Suif –
1883 : Maupassant, Une Vie –
1883 : Maupassant, Les Contes de la bécasse –
1884 : Leconte de Lisle, Poèmes tragiques –
1885 : Zola, Germinal –
1885 : Maupassant, Bel-Ami –
1885 : Maupassant, Le Horla –
1888 : Maupassant, Pierre et Jean –
1890 : Zola, La Bête Humaine –
13 janvier 1898 : Zola, « J’accuse » |
|
|
|
Le réalisme se développe dans le roman contre le sentimentalisme romantique. Il cherche à dépeindre la réalité telle qu'elle est, sans idéalisation, choisissant parfois ses sujets dans les classes moyennes ou populaires, et abordant des thèmes contemporains et quotidiens (les relations conjugales, les affrontements sociaux…). « Un roman est un miroir qui se promène sur une grande route » (Stendhal) Les
auteurs principaux : Stendhal et Balzac (encore proches du romantisme), Flaubert (bien qu’il ait refusé l’étiquette de réaliste), Maupassant (proche du naturalisme) Les genres littéraires principaux : Roman |
|
||
|
Le naturalisme prolonge le réalisme dans son souci de dépeindre la réalité, mais il y ajoute des considérations scientifiques. Selon Zola, le roman naturaliste vise « l'étude de l'homme naturel, soumis aux lois physico-chimiques et déterminé par les influences du milieu ». Dans la préface des Rougon-Macquart, Zola déclare : « Je veux expliquer comment une famille, un petit groupe d'êtres, se comporte dans une société, en s'épanouissant pour donner naissance à dix, à vingt individus qui paraissent, au premier coup d'œil, profondément dissemblables, mais que l'analyse montre intimement liés les uns aux autres. L'hérédité a ses lois, comme la pesanteur ». Les
auteurs principaux : Zola, Maupassant ( ?) Les genres littéraires principaux : Roman, essais |
|
||
|
Le Parnasse est une réaction contre les excès lyriques et sentimentaux du romantisme qui mettent en avant les épanchements sentimentaux aux dépens de la perfection de la forme. Mouvement poétique apparu dans la seconde moitié du XIXe siècle, le Parnasse veut valoriser la poésie par la retenue et l'impersonnalité, rejetant l'engagement social et politique de l'artiste. L'art n'a pas à être utile ou vertueux, son seul but est la beauté : c'est la théorie de « l'art pour l'art » de Théophile Gautier (« Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien, tout ce qui est utile est laid. »). On réhabilite le travail acharné et minutieux de l'artiste (avec la métaphore de la sculpture pour indiquer la résistance de la « matière poétique »). Les
auteurs principaux : Théophile Gautier (également romantique), Leconte de Lisle, Théodore de Banville, ainsi que les participants aux trois recueils du Parnasse contemporain. Les genres littéraires principaux : Poésie |
|
||
|
Le symbolisme apparaît vers 1870 en réaction contre le
rationalisme du naturalisme et contre la froideur du Parnasse. Contrairement aux naturalistes les symbolistes ne décrivent pas fidèlement la réalité, , ils recherchent une impression, une sensation, qui évoque un monde idéal et privilégient l'expression des états d'âmes : il s'agit de « vêtir l'idée d'une forme sensible ». Les correspondances des sens (sons, couleurs, visions) permettent au poète d’en révéler les mystères. Le symbolisme veut souligner les rapports subtils entre une idée abstraite et l’image qui va l’exprimer, c’est un art de la nuance : « Car nous voulons la Nuance
encore, Pas la Couleur, rien que la
nuance ! Oh ! la nuance seule fianceLe rêve au rêve et la flûte au cor ! » Verlaine Les
auteurs principaux : Verlaine, Baudelaire ( ?), Rimbaud ( ?), Mallarmé, Apollinaire, Jarry, Laforgue, Lautréamont, Maeterlinck, Valéry, Verhaeren, Villiers de L'Isle-Adam Les genres littéraires principaux : Poésie |
|
||
|
XXe |
|
Roger GILBERT-LECOMTE PRÉVERT ANOUILH Jean GIRAUDOUX |
|